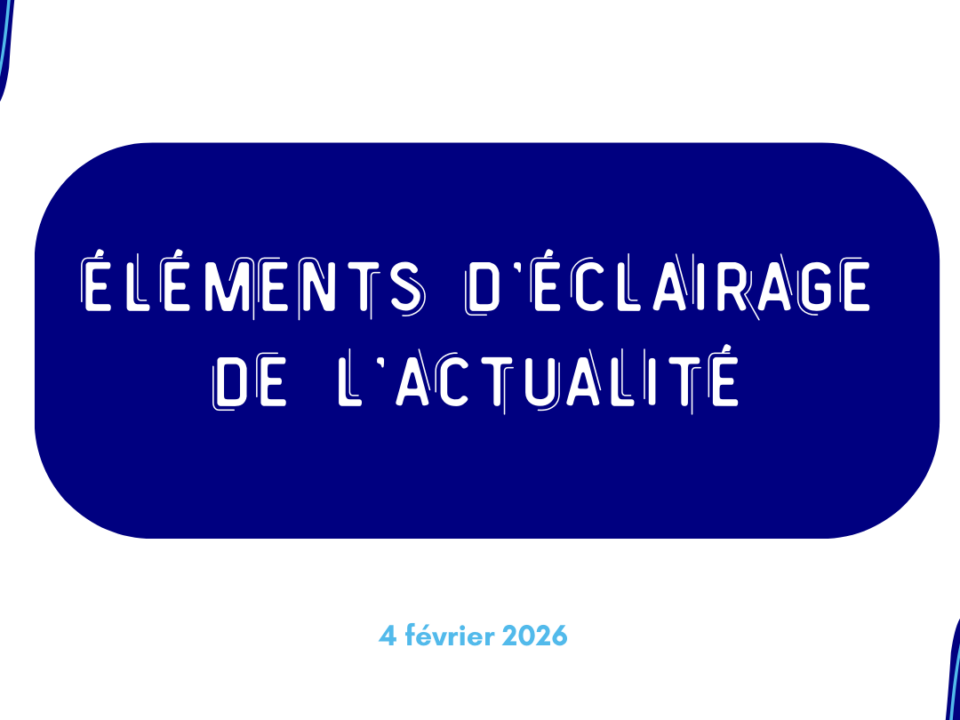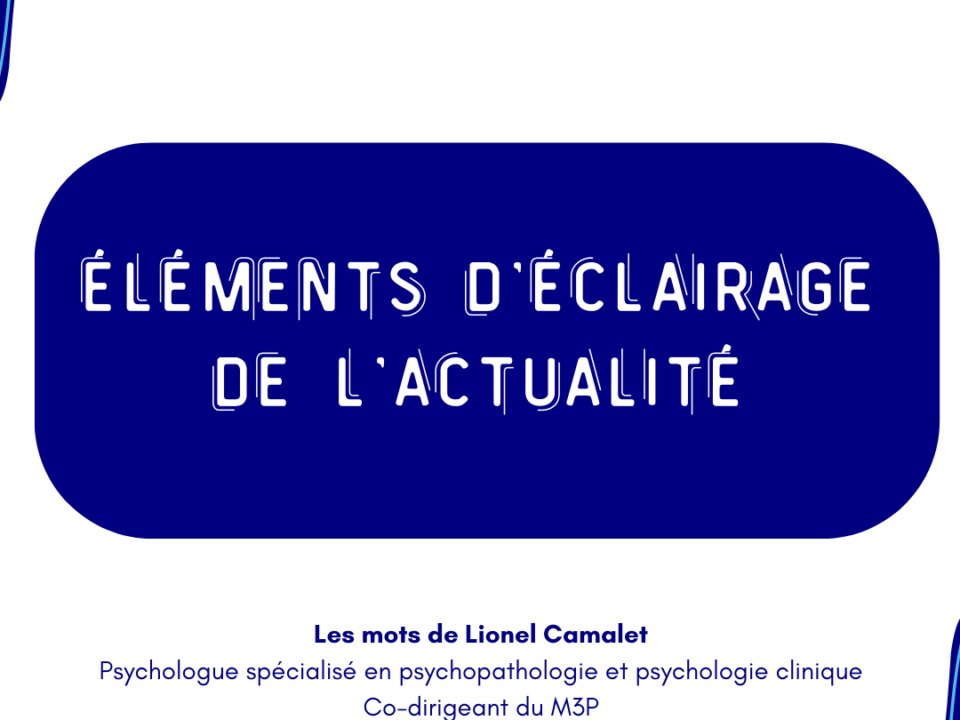Communiqué commun – Fin de la pluralité des approches : une psychologie et une psychiatrie d’état ?
27 octobre 2025« La pluralité des approches psychothérapeutiques n’est pas négociable » – Communiqué du 16 novembre 2025
16 novembre 2025Chronique du 4 novembre 2025
Le Code de déontologie des psychologues : une boussole éthique face aux dérives politiques et médiatiques.
Aurélie Martin, Cyrille Le Jamtel, Lionel Camalet – Co-dirigeants de l’Association M3P
“Ce n’est pas à l’éthique de se soumettre à la politique, c’est à la politique de ne pas faire obstacle à l’éthique.”
Mony Elkaïm, Si tu m’aimes, ne m’aime pas, Seuil, 2003.
Depuis plusieurs années, les psychologues de France se mobilisent pour défendre leur profession face à une série d’attaques institutionnelles. Dispositifs protocolisés, tentative d’encadrement hiérarchique par le médico-légal, injonctions à la rentabilité, pressions à l’adhésion à des modèles normés et réductionnistes du soin psychique, vulgarisations médiatiques : autant de menaces qui viennent heurter les fondements même du soin psychique. Dans ce contexte, le Code de déontologie rédigé par et pour les psychologues apparaît plus que jamais comme un rempart, un socle de résistance, une boussole éthique face aux tentatives de normalisation et de domestication de la pensée clinique.
Un fondement éthique partagé par la profession
Adopté pour la première fois en 1996 par les principales organisations représentatives des psychologues, le Code de déontologie n’a pas de valeur juridique contraignante, faute de reconnaissance légale. Pourtant, il est la référence éthique de la profession, un texte fondateur qui encadre les pratiques, protège les usagers et garantit une liberté de pensée, de méthode et de responsabilité individuelle.
Il s’agit d’un contrat moral, librement consenti par les psychologues, qui fonde leur légitimité. Ce Code est le seul texte qui unit la profession autour de principes fondamentaux : respect de la personne, secret professionnel, autonomie du jugement, responsabilité du psychologue, pluralisme des méthodes, refus de la soumission à des intérêts extérieurs à la relation de soin.
Une profession entre éthique et injonctions institutionnelles
Or, ces principes sont aujourd’hui mis à mal par les orientations prises par les politiques publiques de santé mentale. Les psychologues se voient de plus en plus assignés à des fonctions d’exécutants au service de logiques gestionnaires, évaluatives ou sécuritaires. L’introduction de dispositifs comme le « Mon Soutien Psy », la plateformisation de l’accès aux soins (plateforme TND, par exemple), ou encore la tentative d’intégration forcée dans des hiérarchies médicales menacent directement l’autonomie professionnelle et la diversité des approches psychothérapeutiques.
Les revendications actuelles portées par les collectifs et syndicats de psychologues sont claires : reconnaissance du Code de déontologie dans la loi, respect de l’indépendance clinique, refus de l’alignement sur une médecine normative, défense de la pluralité des références théoriques et des modalités de soins, revalorisation des salaires et arrêt de la précarisation du secteur.
Dans ce paysage conflictuel, le Code fait office de rempart militant : il permet de résister aux dérives protocolaires, de refuser des pratiques imposées qui contreviennent à l’éthique du soin, et de rappeler que le psychologue est d’abord un professionnel du soin psychique, pas un simple technicien du comportement.
Quand le Code rappelle la limite : la souffrance n’est pas un spectacle
L’émission de France Télévisions, « Rendez-vous chez le psy », filme et diffuse de véritables séances psychothérapeutiques. Une mise en scène qui transgresse frontalement plusieurs principes du Code : respect de la dignité de la personne, confidentialité, refus d’instrumentaliser la clinique. La souffrance intime n’est pas un divertissement. Elle ne peut être exposée pour faire de l’audience.
Dans un autre registre, mais selon une logique voisine, la plateforme Psyflix s’affiche comme le « Netflix de la psychothérapie ». Derrière la promesse de rendre accessible la formation continue, se profile une standardisation de la clinique réduite à un catalogue de « séances types » filmées et de modèles validés. Observer une séance enregistrée ne saurait remplacer l’expérience vivante d’une rencontre singulière entre un psychothérapeute et une personne.
Ces deux exemples, apparemment éloignés, participent pourtant d’un même mouvement de spectacularisation et de marchandisation du soin psychique. Comme l’a montré Roland Gori (La fabrique des imposteurs, 2013), le néolibéralisme tend à transformer toute pratique en performance mesurable et en marchandise. De même, Eva Illouz (Les émotions capitalistes, 2006) analyse comment les affects eux-mêmes sont intégrés dans les logiques de marché, tandis que Byung-Chul Han (La société de la fatigue, 2010) met en lumière le glissement vers une société de performance où l’intime se consomme et s’exhibe.
Dans ce contexte, le Code de déontologie des psychologues n’est pas un vestige du passé : il demeure une boussole éthique et politique. Comme le souligne René Kaës (L’éthique du psychanalyste, 2009), la clinique repose sur une responsabilité à l’égard de l’autre, qui ne peut être déléguée aux normes gestionnaires ni aux logiques médiatiques. Le Code rappelle que le soin psychique repose sur le respect de la singularité, l’accueil de la parole, la construction d’une alliance thérapeutique qui ne peut être filmée, mise en vitrine ou transformée en produit marchand.
Une protection du public : vers un délit d’exercice illégal de la psychothérapie
Face à ces tensions, un courant de réflexion émerge autour d’une proposition alternative à la création d’un Ordre des psychologues : l’inscription dans la loi d’un délit d’exercice illégal de la psychothérapie. Inspirée du délit d’exercice illégal de la médecine, cette mesure aurait pour effet de renforcer la protection du public contre les pratiques potentiellement dangereuses émanant de personnes non formées ou relevant de courants sectaires.
Cette proposition s’inscrit dans une logique de responsabilisation et non de contrôle disciplinaire. Elle permettrait de distinguer clairement les professionnels formés à la psychothérapie (psychologues, psychiatres, psychothérapeutes reconnus) des acteurs non qualifiés se revendiquant abusivement de cette pratique. Elle rejoint ainsi les préoccupations exprimées de longue date par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), qui alerte sur les risques de prolifération de pratiques pseudo-thérapeutiques non encadrées.
Un tel délit permettrait de protéger les usagers sans instaurer une autorité centralisée ni normative sur les professionnels légitimes. Il irait dans le sens d’un équilibre subtil entre liberté thérapeutique et sécurité publique, en posant des critères clairs de formation et de référence tout en respectant la pluralité des approches du soin psychique.
Résister, c’est exister : éthique et politique du soin
Dans un monde où la santé mentale se confond avec l’optimisation de soi, tenir à une éthique du soin, c’est un acte politique. Le Code de déontologie ne se contente pas de dire ce qu’un psychologue peut ou ne peut pas faire : il incarne une vision de la relation humaine, une éthique de la complexité, un refus du pouvoir unilatéral.
Revendiquer l’autonomie professionnelle, c’est défendre une conception du soin qui ne réduit pas l’humain à ses symptômes ni le psychothérapeute à un prescripteur de protocoles. C’est rappeler que le soin psychique est un espace de parole, de subjectivation, de transformation, et non un dispositif de conformité sociale.
En conclusion : faire du Code de déontologie un outil de résistance et de protection
Alors que la profession est menacée d’être dissoute dans des logiques médicales ou marchandes, le Code de déontologie est plus que jamais un levier de mobilisation collective. Il appartient aux psychologues de s’en emparer, de le défendre, de le faire vivre dans leur pratique quotidienne, mais aussi dans l’espace public.
Et parce que protéger la profession, c’est aussi protéger les usagers, l’instauration d’un délit d’exercice illégal de la psychothérapie constitue une innovation juridique légitime, protectrice, non normative, et compatible avec une éthique fondée sur l’autonomie et la pluralité.
Notre responsabilité est claire : défendre la dignité de la personne, la pluralité des approches, et la liberté de pratiquer selon notre éthique. Le Code de déontologie n’est pas qu’un texte. C’est un outil de résistance, un acte de protection pour les patients comme pour les psychologues. C’est lui qui nous permet de dire non aux dérives, et oui à une clinique vivante, exigeante et profondément humaine.
Défendre le Code de déontologie, c’est défendre la liberté de penser,
le respect des personnes, et un soin psychique humain et démocratique.