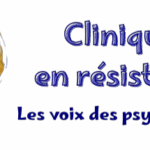
Chronique du 15 Septembre 2025
15 septembre 2025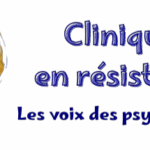
Chronique du 29 Septembre 2025
28 septembre 2025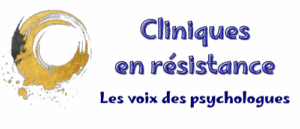
Chronique du 22 septembre 2025
Défendre le soin psychique contre l’idéologie de la santé mentale
Aurélie Martin, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Elle s’assoit, les épaules voûtées, et murmure :
« On me répète que je dois reprendre le travail… Mais je n’y arrive pas. Alors ça veut dire quoi ? Que je suis malade ? Que je ne vaux plus rien ? Trois mois d’arrêt, et déjà on me regarde comme si j’exagérais, comme si c’était honteux. »
Ces phrases, je l’ai entendue plus d’une fois. Comme si ne plus « produire » suffisait à invalider l’existence, comme si l’absence d’emploi ou d’efficacité sociale était un signe de pathologie. Dans l’air du temps, ce glissement est partout. On ne dit plus « souffrance psychique », on dit « santé mentale ». On ne dit plus « prendre soin », on parle « d’optimiser son bien-être ».
Mais que recouvre cette fameuse santé mentale ? L’Organisation Mondiale de la Santé en donne une définition limpide : « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’apporter une contribution à la communauté » (OMS, 2001).
Relisons bien : travailler « avec succès et de manière productive », contribuer à la société, réaliser son potentiel. Qui peut se reconnaître dans cette norme permanente de performance ? Que dire de ceux qui n’ont pas d’emploi, ou qui ne veulent pas d’une vie placée sous le signe de la productivité ? De celles et ceux qui n’apportent pas une « contribution mesurable » à la communauté ? Sont-ils exclus du champ de la santé mentale ?
Cette définition n’est pas neutre. Elle dit quelque chose de notre époque : une époque où la valeur d’une existence se mesure à sa rentabilité sociale, à son utilité économique, à sa capacité d’adaptation. Ce n’est pas seulement une impression : des sociologues et philosophes ont montré combien nos sociétés fabriquent elles-mêmes la souffrance qu’elles prétendent soigner. Alain Ehrenberg (1998) analyse comment la dépression est devenue le « mal du siècle », non pas comme simple trouble individuel, mais comme le revers d’une société qui exige autonomie, performance et responsabilité permanente des individus. Eva Illouz (2006) montre comment le capitalisme s’est emparé des affects et des émotions, en les transformant en ressources productives et en marchandises. Byung-Chul Han (2010) décrit le passage d’une société disciplinaire à une société de performance, où l’injonction à l’auto-réalisation conduit paradoxalement à l’épuisement, à la dépression et au burn-out.
En France, ce langage n’est plus seulement une mode : il est devenu un projet politique.
2025 a été proclamée Grande cause nationale pour la santé mentale. Derrière l’affichage louable, quel horizon s’esquisse ? Celui d’une santé psychique mesurée en indicateurs, en grilles, en bilans populationnels. Une santé mentale réduite à la prévention des coûts sociaux, au maintien au travail, à la performance collective.
Face à cela, je défends une autre voie : celle du soin psychique. Le soin psychique ne demande pas à être productif. Il ne fixe pas d’objectifs de rendement. Il n’impose pas de contribuer à la société. Il accueille la personne dans ce qu’elle traverse, même si c’est l’épuisement, même si c’est le refus, même si c’est le retrait.
Le soin psychique, c’est entendre la singularité plutôt que de mesurer l’adaptation. C’est accueillir la parole qui hésite, les silences qui pèsent, les contradictions qui se bousculent. C’est se tenir au plus près de ce qui échappe aux normes, là où la vie résiste.
En parlant de « santé mentale », les pouvoirs publics organisent une clinique utilitaire : une clinique qui veut réparer vite, pour remettre au travail, pour réadapter à la société. En défendant le soin psychique, nous rappelons qu’une psychothérapie n’est pas un outil de normalisation, mais un espace d’hospitalité. Un lieu où l’on ne demande pas d’être performant, mais d’être humain.
Ce n’est pas une abstraction : chaque jour, nous recevons des personnes qui se sentent coupables de ne pas « produire assez », comme si leur valeur dépendait de leur rendement.
Alors oui, les mots comptent. Défendre le soin psychique contre l’idéologie de la santé mentale, c’est refuser de laisser la productivité définir le vivant. C’est maintenir un espace fragile mais essentiel : celui où chaque existence, même vacillante, a droit d’être entendue.
La santé mentale veut produire des sujets adaptés.
Le soin psychique, lui, s’obstine à accueillir des êtres humains.
Références bibliographiques
OMS (2001). Définition de la santé mentale.
Ehrenberg, A. (1998). La fatigue d’être soi. Dépression et société. Paris : Odile Jacob.
Illouz, E. (2006). Les émotions capitalistes. Paris : Seuil.
Han, B.-C. (2010). La société de la fatigue. Paris : Actes Sud.
Gouvernement français (2025). Proclamation de la santé mentale comme Grande cause nationale.
