« Rendez vous chez le psy » : l’alerte du M3P n’a pas été vaine
19 novembre 2025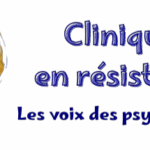
Chronique du 8 décembre 2025
7 décembre 2025Chronique du 24 novembre 2025
Défendre la psychologie comme science humaine
La psychologie se tient à l’intersection du biologique, du relationnel, du culturel et du symbolique. En rappeler la dimension de science humaine, c’est affirmer une manière de penser le psychique, de faire science, et de concevoir la clinique.
Dire que la psychologie est issue des sciences humaines et sociales, c’est rappeler une filiation essentielle, celle qui ancre la clinique dans l’humain vivant, situé, traversé par son histoire, ses liens, ses appartenances, ses contextes.
Sous cette bannière se loge une idée simple : le psychisme n’est jamais un territoire isolé ; il se façonne au croisement des relations, des héritages, des environnements et de son ancrage biologique. Et soigner le psychisme, c’est penser et accueillir tout cela.
Irvin Yalom rappelait que nous sommes tous un peu des îles ; mais des îles traversées de ponts fragiles, de passages, de détroits. Le psychisme ne se comprend qu’en explorant ces liens qui nous relient, nous séparent, nous façonnent.
Ce préambule ouvre des perspectives cliniques, épistémologiques et politiques :
Une science du sujet, pas une mécanique du cerveau
Les sciences humaines et sociales étudient l’humain en situation : ses choix, ses conflits, ses représentations, ses émotions, ses manières d’habiter le monde.
Dire que la psychologie est issue des sciences humaines et sociales, c’est affirmer que notre objet n’est ni un organe, ni un dysfonctionnement technique, mais un sujet avec une histoire, une parole, un monde relationnel.
Et parce qu’elle relève des sciences humaines, la psychologie porte aussi un rapport spécifique à la recherche scientifique : une recherche qui interroge le sens, les contextes, les dynamiques relationnelles etc.
Elle s’appuie sur un champ particulièrement riche et diversifié : des dizaines de laboratoires universitaires, une production scientifique abondante, des approches multiples qui font dialoguer clinique, cognition, développement, psychopathologie, neurosciences, psychologie sociale, et du travail etc.
Une compréhension du psychique comme phénomène relationnel
La psychologie plonge ses racines dans des disciplines qui pensent le lien :
– la philosophie (la conscience, l’expérience intérieure),
– la sociologie (les normes, les systèmes, le collectif),
– l’anthropologie (la culture, les récits, les rituels),
– la linguistique (le langage, la symbolisation),
– la psychanalyse (l’inconscient, le transfert, les conflits internes et leur mise en scène relationnelle),
– et, plus récemment, les neurosciences, qui montrent comment le lien, l’environnement et l’expérience transforment la plasticité du vivant.
Chacune éclaire une facette du psychisme.
La psychanalyse rappelle que nos mouvements internes sont habités par des traces, des histoires, des scènes relationnelles qui continuent de travailler le présent.
Les neurosciences montrent que le cerveau est un organisme vivant, plastique, modelé par l’expérience, les interactions, le sens que nous donnons aux événements.
Ensemble, même si elles parlent des langues différentes, elles convergent vers une évidence :
Le psychisme n’est jamais une donnée isolée. Il se co-construit dans le lien, dans le temps, dans la relation.
Une méthode qui passe par la rencontre
Les sciences humaines ont développé des méthodes qui ne réduisent pas l’humain à des chiffres : l’entretien, l’observation clinique, la narration, l’analyse des interactions etc.
La psychologie en hérite. Elle avance par dialogue, par élaboration, par construction de sens, pas par simple mesure.
Cela ne s’oppose pas à la science : cela décrit un autre régime de scientificité, plus proche de la complexité humaine.
Une éthique de la singularité
Être issue des sciences humaines et sociales, c’est s’inscrire dans une tradition qui protège la pluralité, la contextualité, la subjectivité.
Cela veut dire :
- qu’on ne soigne pas deux personnes de la même manière ;
- qu’on ne réduit pas le soin à une procédure ;
- qu’on accueille la personne dans son histoire, et non dans un protocole.
La singularité humaine n’est pas un détail : c’est notre matière première.
Une discipline qui dialogue avec le vivant
La psychologie n’est pas en dehors de la biologie ou des neurosciences — mais elle ne s’y réduit pas.
C’est le croisement de ces mondes — le corps, l’histoire, le lien, la culture — qui donne à la psychologie sa texture unique.
C’est cette hybridité qui fait sa force : une science ancrée dans le vivant, mais attentive à la complexité du sens.
Dire que la psychologie est issue des sciences humaines et sociales, c’est rappeler que notre clinique s’exerce dans la nuance, sous le signe de la rencontre, de l’interprétation, du lien et de l’histoire.
C’est affirmer que l’humain ne se répare pas comme une machine : il se comprend, se reconstruit, se symbolise, dans un espace où quelqu’un l’écoute vraiment.
