Chronique du 18 août 2025
18 août 2025Chronique du 1er Septembre 2025
31 août 2025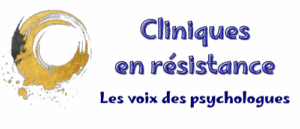
Chronique du 25 août 2025
Le cabinet libéral, lieu d’une clinique politique ?
Aurélie Martin – Psychologue clinicienne et Psychothérapeute – Co-dirigeante du M3P
Le mot politique ne désigne pas ici une affiliation partisane, mais les structures de pouvoir, les normes sociales et les choix collectifs qui façonnent nos vies. Le politique traverse les récits des patients (discriminations, précarité, violences systémiques), les conditions d’exercice des psychologues (isolement, injonctions à l’efficacité, absence de reconnaissance), et les actes cliniques eux-mêmes (prendre le temps, accueillir le singulier, refuser la standardisation).
On pense souvent le cabinet libéral comme un refuge, un abri silencieux, protégé des fracas du monde. On l’imagine en retrait, neutre, affranchi des tensions sociales. Mais rien n’est plus trompeur. Le politique, ici aussi, est à l’œuvre. Il ne se manifeste pas seulement dans les slogans ou les lois. Il se glisse dans les corps, les silences, les récits.
Dans ce lieu apparemment intime, nous accueillons chaque jour les conséquences d’un monde qui laisse des traces. Ce sont des histoires de classe, de genre, de domination, de rupture. Et nous, psychologues, travaillons dans cette porosité constante entre l’individuel et le collectif. Soigner ici, c’est toujours, d’une certaine manière, interroger les contextes qui le constituent.
Un homme de 55 ans. Cadre, performant, l’image d’un homme « qui gère ». Mais sous le vernis, une fatigue immense. Il en a assez de faire semblant. Depuis l’enfance, il a appris que pleurer, c’était trahir son genre. Que montrer ses émotions, c’était être faible, être « une fille » disait son père, comme une insulte. Alors il s’est muselé. Il a grandi avec l’idée qu’il fallait tenir, toujours, à tout prix. Aujourd’hui, il voudrait poser l’armure, mais il ne sait pas comment. Dans le cabinet, il cherche un autre langage, une autre façon d’être homme. Il découvre que cette souffrance n’est pas seulement la sienne : c’est celle d’un modèle viriliste qui colonise les corps et les cœurs. L’écouter, soigner ici, c’est reconnaître que cette norme est politique. Et qu’y résister, ici, dans cet espace intime, est déjà un acte de transformation.
Une femme de 45 ans. Elle a mal partout. Une douleur diffuse, persistante, que les examens ne savent expliquer. On l’appelle fibromyalgie. Mais dans ses silences, dans sa posture effacée, dans ses hésitations à dire « j’ai mal », résonne autre chose : une histoire d’injonctions à se taire, à ne pas déranger, à plaire sans jamais peser. Elle a grandi dans l’ombre d’une mère méprisante, dans une maison où sa souffrance n’avait pas droit de cité. Alors aujourd’hui, c’est son corps qui parle à sa place, malgré elle. Et dans le cabinet, ce n’est pas seulement une douleur que nous écoutons, c’est un rapport au monde, forgé par la honte, le silence et la dévalorisation. C’est la trace sensible d’une violence structurelle qui n’a pas laissé de bleus, mais qui marque en profondeur. Soigner ici, c’est reconnaître cette mémoire sociale inscrite dans la chair.
Une jeune femme de 21 ans. Elle a le regard franc, les mains qui tremblent. Elle a traversé l’abus, la trahison, le silence familial. Pas seulement la violence d’un homme, mais celle d’un système qui l’a laissée sans mots, sans protection. Elle dit : « J’ai envie de comprendre. De pas reproduire. » Elle est là, droite dans sa fragilité, debout dans un monde qui a tenté de la faire taire. Et dans cet instant suspendu, la clinique devient politique, car ce que nous explorons ensemble, ce n’est pas seulement son histoire, mais ce que cette histoire révèle d’une culture du déni, de l’impunité, du non-dit. Soigner ici, c’est résister à l’effacement. C’est lui offrir un lieu où sa parole compte. Où son regard peut enfin être soutenu.
Nous recevons aussi les stigmates d’un système. Ceux qui ont franchi bien des obstacles pour arriver jusqu’ici, et qui parfois sacrifient autre chose pour pouvoir s’offrir un espace de parole. Ceux qu’on a renvoyés à des « troubles de la personnalité » quand c’était leur histoire, pas leur structure, qui appelait une écoute. Ceux qu’on a médicalisés sans leur laisser le temps de parler. Soigner ici, c’est proposer un espace de réparation partielle, mais aussi un lieu de résistance éthique.
Et nous, dans nos cabinets, nous tenons. Mais souvent seuls. Sans collectif institutionnel, sans appui structuré. Le statut libéral, s’il garantit une certaine autonomie, impose aussi ses lourdeurs : charges sociales élevées, absence de congés payés, protection sociale lacunaire, incertitude sur les retraites. Nous exerçons dans l’entre-deux : libres, mais sans filet. Et pourtant, nous y croyons. Parce qu’ici, il y a encore de la place pour la lenteur, pour le doute, pour l’humanité. Ce qui nous soutient, ce sont les supervisions entre pairs, ces espaces précieux où la pensée peut encore circuler, se questionner, se relier. Soigner en libéral, aujourd’hui, c’est tenir une position politique fragile mais tenace, au croisement de la clinique, de l’économie, de l’éthique et de la solidarité.
La clinique, même en libéral, n’est jamais déconnectée du monde. Elle est traversée, imbriquée, inséparable. Elle est l’éclat intime d’un malaise collectif. Elle ne soigne pas le politique, mais elle en révèle les effets et parfois, elle les transforme.
Alors oui, le cabinet libéral est un lieu politique.
Pas parce que nous y faisons de la politique partisane, mais parce que nous y restaurons des marges d’humanité dans un monde qui tend à les rogner.
Parce que nous y défendons une parole située, incarnée, résistante.
Dans ce lieu, nous œuvrons pour une clinique qui pense, qui s’ajuste, qui refuse de céder à la normativité. Une clinique où chaque récit compte. Où chaque silence a le droit d’exister. Où le soin psychique reste un acte profondément humain… donc profondément politique.
