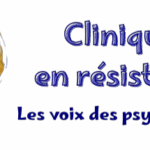
Chronique du 22 Septembre 2025
20 septembre 2025Contre la téléréalité de la psychothérapie
3 octobre 2025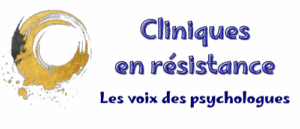
Chronique du 29 septembre 2025
Le symptôme comme tentative de solution
Aurélie Martin, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Dans nos pratiques, combien de fois entendons-nous cette demande : « Enlevez-lui ses crises », « qu’elle cesse ses colères », « qu’il arrête ses obsessions ». Comme si le symptôme n’était qu’une verrue à cautériser, un dysfonctionnement qu’il suffirait de réparer pour que la vie reprenne son cours normal.
Mais le symptôme, en clinique, n’est jamais un simple accident. Il est, comme l’écrivait Guy Ausloos, une tentative de solution (Ausloos, G. (1995). La compétence des familles : Temps, chaos, processus. Paris : ESF.). Une manière, souvent maladroite et coûteuse, qu’a trouvé un être humain pour tenir debout dans un contexte insupportable.
Alors, plutôt que de s’acharner à le supprimer trop vite, il nous faut d’abord l’écouter. Le symptôme raconte quelque chose de la personne et de son histoire, il témoigne d’une inventivité vitale. L’enfant qui s’enferme dans ses rituels ne cherche pas à compliquer la vie de ses parents : il tente de maîtriser un monde qui lui échappe. L’adolescente qui s’écorche la peau ne cherche pas la douleur pour elle-même : elle invente un langage pour dire ce qui n’arrive pas à se dire autrement.
Accueillir le symptôme comme une tentative de solution, c’est donc résister à la tentation du « réparer vite », du protocole qui gomme sans comprendre, du soin psychique réduit à un résultat chiffré qui permettra d’être « productif ». C’est prendre le temps d’explorer le sens du geste, la logique du comportement, le fil invisible qui relie l’expression de la souffrance à l’histoire singulière de celui ou celle qui en porte le poids.
Car si le symptôme est une tentative de solution, alors le soin psychique n’est pas une guerre contre lui. Il est un espace pour en déplier la logique, pour entendre ce qu’il dit et ce qu’il protège, pour accompagner la personne vers d’autres façons d’exister. Cela suppose de la patience, de l’humilité, et ce regard clinique qui se tient aux côtés du patient, plutôt que de vouloir le normaliser.
Je pense à ce patient, un homme de cinquante ans, venu me voir avec une lourde fatigue et une hypersomnie sévère. Depuis des mois, il dort presque sans fin, comme si la vie elle-même était devenue trop lourde à porter. Pourtant, son parcours dit autre chose qu’une simple « dépression ».
Cet homme a grandi dans une enfance marquée par la violence, les humiliations, l’isolement. Et il porte en lui une scène restée en suspens : la mort de sa mère. Il se souvient, il croit se souvenir, mais il doute sans cesse de la véracité de ses images. « Est-ce mon père qui l’a tuée ? » Cette question lancinante le hante depuis des décennies, sans réponse certaine, mais avec une empreinte indélébile.
Pendant des années, il avait trouvé une forme de stabilité dans sa vie d’adulte. Marié avec son compagnon, il avait pu construire un espace plus apaisé, une relation qui, un temps, l’a protégé. Mais un harcèlement au travail a tout récemment fait vaciller. Les anciennes blessures se sont rouvertes, réveillant une angoisse sourde, un sentiment d’impuissance qui le submerge à nouveau.
Dans ce contexte, comment ne pas entendre que son hypersomnie est plus qu’un « symptôme » ? Elle est une manière de se protéger, de se retirer d’un monde qui le blesse à nouveau. Dormir devient ici une tentative de solution : s’éteindre plutôt que d’être détruit, suspendre le temps plutôt que de s’effondrer. C’est cela que nous rappelle Guy Ausloos : le symptôme n’est pas seulement une plainte, il est tentative de solution. Il est déjà un effort, une invention, même bancale.
Accueillir ses symptômes comme des tentatives de solution, c’est refuser de les réduire à une liste de critères diagnostiques. C’est reconnaître en eux une logique de survie, une tentative, même fragile, de continuer à vivre malgré l’indicible.
Bien sûr, les médicaments peuvent parfois aider : ils atténuent l’intensité des symptômes, redonnent un peu d’air, permettent de retrouver une stabilité suffisante pour affronter le quotidien. Mais ils ne suffisent pas. Car réduire le soin à un traitement pharmacologique, c’est oublier que le symptôme dit quelque chose, qu’il a une fonction et une logique qu’aucune molécule ne peut seule déplier.
De la même manière, croire qu’à chaque trouble correspondrait une méthode thérapeutique unique serait une illusion dangereuse. « Un trouble – une méthode » : cette logique ignore la singularité des parcours et l’inventivité de chaque symptôme. Là où les classifications voudraient ranger et standardiser, le soin psychique demande discernement, écoute et créativité.
Alors le soin psychique n’est pas une lutte contre les symptômes. Il est un espace pour les écouter, les déplier, comprendre ce qu’ils protègent et ce qu’ils expriment. Petit à petit, au fil des séances, le patient peut entrevoir que ses réactions appartiennent à son histoire qui ne résume pas toute son existence. Que d’autres issues sont possibles, que d’autres façons d’habiter son vécu peuvent émerger.
Peut-être est-ce cela, au fond, notre responsabilité : ne pas confondre disparition et guérison. Ne pas croire qu’en effaçant le symptôme, nous aurions fait disparaître la douleur qui l’a engendré. Mais accompagner l’émergence d’autres solutions, plus souples, plus vivantes, plus libres. Car si nous allons trop vite, si nous voulons supprimer sans comprendre, nous risquons d’ajouter une nouvelle violence à celles déjà vécues. Prendre le temps d’écouter le symptôme, c’est honorer le chemin parcouru. C’est ouvrir la possibilité qu’un jour, une autre solution advienne, moins douloureuse, plus vivante.
Le symptôme reste une tentative de solution.
Ce patient qui dort sans fin me le rappelle, comme les autres d’ailleurs : le soin psychique n’est pas de l’ordre de la réparation rapide. C’est un accompagnement patient, une hospitalité au temps long, une manière de rester au plus près du vivant, même quand il cherche refuge dans l’ombre.
Et nous, psychologues, sommes les artisans de cette hospitalité qui refuse de précipiter la réparation, pour laisser au vivant le temps de se réinventer. Ce n’est pas apporter la réponse, mais créer les conditions pour qu’elle puisse advenir, dans l’épaisseur singulière de chaque existence.
