Contre la téléréalité de la psychothérapie
3 octobre 2025Articles et interview du M3P : « Rendez-vous chez le psy » : quand la télévision s’invite dans le soin psychique
11 octobre 2025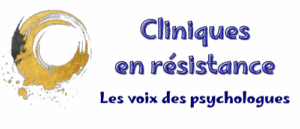
Chronique du 6 octobre 2025
Enjeux cliniques de la vulgarisation
Un exercice de respiration peut contenir une angoisse. Mais présenté comme « solution miracle », il devient un mensonge.
En séance, il m’arrive de proposer un exercice de respiration, une technique d’ancrage, un outil concret. Mais jamais comme une recette magique, jamais hors sol. Ces gestes prennent sens dans une histoire, à un moment précis du parcours psychothérapeutique, quand par exemple, l’anxiété est si envahissante qu’il faut d’abord stabiliser pour pouvoir ensuite élaborer.
Dans ce même esprit, la psychoéducation prend toute sa valeur. Expliquer à une personne ce qu’est un cercle anxieux, ce que produit un traumatisme ou pourquoi son sommeil est perturbé, ce n’est pas simplifier sa souffrance : c’est lui donner des repères. Cela peut déculpabiliser [« ce n’est pas moi qui suis fou, il y a une logique à ce que je vis »] et offrir des points d’appui pour avancer.
Comme le souligne Irvin Yalom, la transparence et la transmission peuvent faire partie intégrante de la relation thérapeutique, quand elles soutiennent le travail plutôt qu’elles ne l’enferment. Et comme l’évoque, Cyril Tarquinio (2019, 2021), les éclairages donnés par la psychologie sur les émotions ne prennent sens que lorsqu’ils sont replacés dans l’histoire singulière de la personne. C’est à cette condition qu’ils peuvent restaurer un véritable pouvoir d’agir. Mais encore une fois, cela n’a de sens que dans la rencontre, dans le moment juste, et non comme une fiche de conseils génériques.
Ce qui m’inquiète, c’est quand ces mêmes outils circulent comme des slogans détachés de tout contexte : « 5 astuces pour aller mieux », « 3 étapes pour vaincre l’angoisse », « la méthode miracle contre le stress ». Dans le flux des réseaux sociaux, la complexité de l’existence se réduit à des « tips » interchangeables. Et cette réduction, loin d’apaiser, enferme.
Roland Gori, dans « La fabrique des imposteurs », alerte sur cette dérive : une société qui transforme le savoir en marchandise et l’humain en objet de normalisation. Les recettes toutes faites séduisent parce qu’elles donnent l’illusion de maîtriser. Mais elles finissent par appauvrir, en niant ce qui résiste, ce qui échappe, ce qui demande du temps. Serge Tisseron rappelle lui aussi que donner du sens suppose d’accueillir la singularité des histoires, pas de les réduire à des outils standardisés.
En psychothérapie, la simplification peut être nécessaire : trouver des mots clairs, rendre accessible ce qui se vit, soutenir une personne dans un moment de débordement. Mais le simplisme est une autre affaire. C’est le moment où la traduction se transforme en trahison. Où l’on fait croire que la souffrance peut être gérée comme une équation. Où l’on oublie que chaque existence a son rythme, sa texture, ses contradictions.
Entre simplification et simplisme, il y a tout l’enjeu d’une clinique vivante. La première éclaire et accompagne. Le second réduit et enferme. Notre responsabilité de psychologues psychothérapeutes, c’est de maintenir cette frontière : rendre intelligible sans jamais appauvrir.
Car le soin psychique n’est pas une collection d’astuces. C’est un travail qui accueille l’incertain et la singularité. Une clinique du temps long, de l’épaisseur humaine, où un exercice de respiration ou une explication ne valent que parce qu’ils sont reliés à une histoire, une parole, une rencontre.
Simplifier, oui, quand c’est au service du lien. Être simpliste, non, car c’est alors toute la richesse de l’humain qui s’éteint.
Références bibliographiques
- Gori, R. (2013). La fabrique des imposteurs. Paris : Les Liens qui libèrent.
- Yalom, I. (2002). Le don de la thérapie. Paris : Galaade.
- Tisseron, S. (2015). Le jour où mon robot m’aimera. Paris : Albin Michel.
- Tarquinio, C. (2019). La santé psychologique : concepts, modèles et interventions. Paris : Dunod.
- Tarquinio, C. (2021). Psychotraumatologie : évaluation, clinique et traitement. Paris : Dunod.
